Les chercheurs et experts
Décrypter les contradictions entre numérique et écologie
Face à la montée en puissance du numérique et à son empreinte écologique croissante, chercheurs et experts jouent un rôle essentiel pour analyser, comprendre et alerter sur les défis posés par cette transformation. Leurs travaux mettent en lumière les contradictions entre transition numérique et écologique, souvent perçues comme complémentaires mais qui, dans les faits, peuvent entrer en conflit.
Ces spécialistes s’attachent à déconstruire le mythe d’un numérique « dématérialisé » et soulignent les coûts environnementaux liés à la fabrication des équipements, à la consommation énergétique des infrastructures et aux nouveaux usages numériques. Ils proposent également des alternatives pour rendre ce secteur plus soutenable, notamment via la sobriété numérique et l’éco-conception.

Un numérique loin d’être immatériel : les critiques des chercheurs (2 exemples)

Fabrice Flipo : une critique radicale de l’illusion numérique
Philosophe et chercheur en sciences sociales, Fabrice Flipo est l’un des principaux penseurs critiques du lien entre numérique et écologie. Dans son ouvrage La numérisation du monde : un désastre écologique (2021), il démontre que le numérique, souvent présenté comme « propre », repose en réalité sur des infrastructures matérielles extrêmement polluantes.
Selon lui, l’essor du numérique repose sur une triple illusion :
- L’immatérialité : On parle souvent d’un « cloud », mais les données sont bien stockées dans des data centers qui consomment énormément d’énergie et d’eau pour leur refroidissement.
- L’optimisation énergétique : Si les technologies numériques deviennent plus efficaces, elles entraînent aussi une augmentation des usages (effet rebond), annulant les gains réalisés.
- L’innovation verte : Contrairement à l’idée reçue, les innovations numériques ne suffisent pas à compenser leur impact environnemental global, car elles encouragent une consommation toujours plus importante de ressources et d’énergie.
Ses recherches dénoncent l’aveuglement des politiques publiques qui misent sur le numérique comme solution aux problèmes écologiques (smart cities, voitures autonomes, intelligence artificielle « verte »), alors que ces innovations génèrent elles-mêmes une pollution massive.

Dominique Carré et Dominique Desbois : les contradictions de la double transition
Dans leurs travaux, Dominique Carré et Dominique Desbois analysent la tension entre transition numérique et transition écologique. D’un côté, le numérique est présenté comme un levier de transformation écologique (capteurs intelligents pour l’économie d’énergie, digitalisation des services pour réduire les déplacements, etc.), mais de l’autre, il est un facteur majeur d’augmentation de la consommation énergétique et des déchets électroniques.
Leur analyse repose sur trois points clés :
- La production massive d’équipements : Chaque année, des millions d’appareils sont fabriqués (smartphones, ordinateurs, objets connectés), nécessitant des ressources rares comme le lithium et le cobalt, souvent extraits dans des conditions écologiquement et socialement désastreuses.
- L’accélération des usages : La multiplication des services numériques (streaming vidéo, cloud computing, intelligence artificielle) entraîne une augmentation exponentielle de la demande en énergie et en stockage.
- Les limites des solutions actuelles : Même les initiatives comme l’économie circulaire ou le recyclage restent insuffisantes pour compenser l’impact du secteur. Par exemple, moins de 20 % des déchets électroniques sont correctement recyclés à l’échelle mondiale.
Ces chercheurs insistent sur la nécessité de repenser le numérique en fonction des contraintes écologiques, plutôt que de le considérer comme une solution universelle.
The Shift Project : promouvoir une sobriété numérique
The Shift Project, un think tank français dirigé par Jean-Marc Jancovici, est l’un des principaux acteurs de la réflexion sur l’impact du numérique sur le climat. Dans son rapport Déployer la sobriété numérique (2018), il met en évidence l’explosion de la consommation énergétique du numérique et propose des solutions pour limiter son empreinte environnementale.
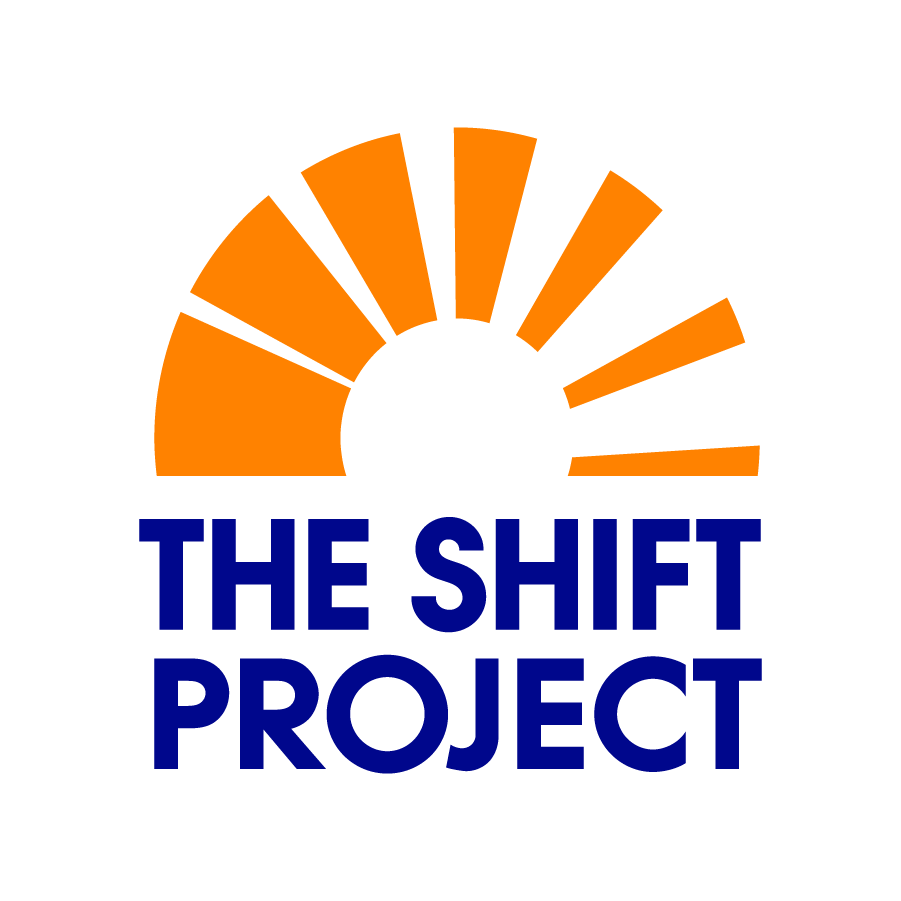
1. Un secteur énergivore en pleine expansion
Selon The Shift Project, le numérique représente aujourd’hui environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre en constante augmentation. L’institut alerte sur plusieurs tendances inquiétantes :
- L’essor du streaming vidéo, qui représente près de 60 % du trafic Internet mondial et dont l’empreinte carbone dépasse celle de l’ensemble du transport aérien mondial.
- La croissance des data centers, dont la consommation énergétique a doublé en 10 ans et continue de croître avec l’intelligence artificielle et le cloud computing.
- L’obsolescence rapide des équipements, qui incite à renouveler les appareils de plus en plus fréquemment, alors que leur fabrication représente 80 % de leur impact carbone total.
2. Les solutions pour un numérique plus responsable
Face à ces constats alarmants, The Shift Project préconise une approche de sobriété numérique, qui repose sur plusieurs leviers :
- Allonger la durée de vie des équipements en favorisant la réparation, le reconditionnement et la mutualisation des ressources (exemple : privilégier les PC fixes plus durables aux laptops jetables).
- Optimiser les usages en réduisant la qualité par défaut des vidéos en streaming, en limitant les e-mails inutiles et en sensibilisant les entreprises à un usage plus mesuré du cloud.
- Réguler la consommation des data centers en imposant des normes plus strictes sur leur efficacité énergétique et en favorisant les énergies renouvelables pour leur alimentation.
L’un des points majeurs soulevés par The Shift Project est que la transition vers un numérique plus écologique ne peut pas reposer uniquement sur des innovations technologiques. Il est nécessaire d’adopter un changement culturel et structurel, qui passe par des politiques publiques plus contraignantes et un engagement des entreprises et des citoyens dans une démarche de sobriété.

Un consensus sur la nécessité d’une régulation, mais des solutions encore insuffisantes
Les chercheurs et experts s’accordent sur plusieurs constats clés :
1. Le numérique n’est pas immatériel et repose sur une infrastructure physique lourde, gourmande en ressources et en énergie.
2. Les gains d’efficacité énergétique sont annulés par l’effet rebond, qui pousse à une consommation toujours plus importante de services numériques.
3. Les solutions actuelles (recyclage, reconditionne-ment, énergies renouve-lables) sont insuffisantes pour compenser l’impact croissant du numérique.
4. La régulation doit être renforcée pour limiter les abus du secteur et encourager une réelle sobriété numérique.
Cependant, les recommandations des experts peinent encore à être mises en œuvre à grande échelle. Les entreprises du numérique continuent de privilégier la croissance des usages, et les politiques publiques restent souvent timides face aux intérêts économiques en jeu.
La question centrale demeure : sommes-nous prêts à repenser notre modèle numérique pour qu’il soit compatible avec les limites planétaires, ou allons-nous continuer à privilégier une expansion sans fin au détriment de l’environnement ?
Les chercheurs et experts continueront d’alerter sur ces enjeux, mais la mise en application de leurs recommandations dépendra de la volonté collective d’engager un véritable changement.
